1
les perturbations électriques : 
Les perturbations
sur une installation électrique peuvent avoir des effets sur :
le courant :
surcharges ou courts circuits
la tension :
surtensions ou baisse de tension
Type
de perturbation |
Causes |
Conséquences |
Protection |
SURCHARGE |
La
puissance demandée est superieure à celle prévue |
échauffement
anormal des conducteurs et des recepteurs, diminution de la durée
de vie du materiel |
-
fusibles
- disjoncteurs
- relais
thermique |
SURINTENSITE |
court-circuit
: deux conducteurs chargés rentrent accidentellement en contact |
le
courant dans les conducteurs devient très important (de l'ordre
de 1000 à 10000A) et peut les faire fondre ou les déformer.
création d'arc électrique pouvant provoquer des incendies,
des brûlures. |
-
fusibles
-
disjoncteurs
-
relais magnétique
(doivent
couper l'alimentation instantanément) |
SURTENSION |
la
tension augmente subitement, du fait de la foudre ou de présence
de ligne haute tension |
Claquage
des isolants, puis apparition de court-circuits. |
-
parafoudre
-
limiteur de surtension
-
relais à maximum de tension |
BAISSE
DE TENSION |
déséquilibre
du réseau triphasé |
mauvais
fonctionnement des moteurs et recepteurs |
-
relais à minimum de tension |
règle
générale
La protection
est assurée lorsque le dispositif de protection permet de laisser passer
le courant d'emploi de l'installation mais coupe l'alimentation lorsque le courant
devient supérieur au courant admissible par l'installation.

2
les fusibles :
2.1
Définition
Le
fusibles est un appareil de protection dont la fonction est d'ouvrir le circuit
dans lequel il est inséré par la fusion d'un élèment
calibré.
Le
fusible doit interrompre le courant lorsque celui-ce dépasse, pendant
un temps donné, une certaine valeur.
2.2
Constitution et cycle de fonctionnement
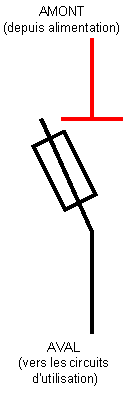  Le
fusible est constitué d'un porte fusible et d'une cartouche fusible. Le
fusible est constitué d'un porte fusible et d'une cartouche fusible.
Sur
l'image ci-contre, on voit un coupe-circuit modulaire équipé d'une
cartouche-fusible.
En
cas de surintensité ou de surcharge, l'élèment fusible
contenu dans la cartouche va fondre et il faudra alors remplacer la cartouche.
Les
fonctions du coupe circuit sont donc de loger la cartouche fusible et de permettre
le sectionnement des circuits situés en aval du coupe circuit.
Etude d'une cartouche-fusible et de son cycle de fontionnement :
 |
La barrette fusible est noyée dans de la poudre de
silice |
PHASE
1 |
PHASE
2 |
PHASE
3 |
PHASE
4 |
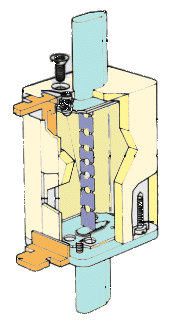 |
 |
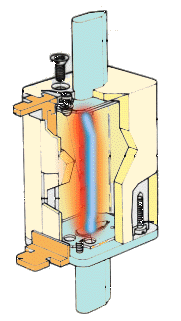 |
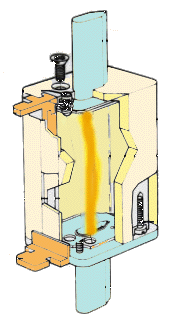 |
| le
courant circule au travers de la cartouche fusible, tant que le courant
ne dépasse pas la valeur nominale, rien ne se passe |
Lorsqu'il
y a une perturbation (surcharge ou surintensité), l'effet joule provoque
un échauffement de la barrette aux points où elle est de plus
fine section. L'échauffement devient tel que la barrette commence
à fondre. |
Au
fur et à mesure que la barette fond, un arc électrique prend
naissance. La chaleur devient très intense et vaporise la barrette.
L'arc électrique posséde une résistance qui a tendance
à faire baisser le courant circulant dans l'installation |
La
chaleur produite par l'arc électrique fait fondre la poudre de silice
(isolant élecrique) qui vient alors éteindre l'arc électrique
: le courant est maintenant interrompu. |
2.3.
Les classes de fusibles
Les
fusibles sont classés en trois classes differentes :
 Classe
gG : ce
sont les fusibles utilisés dans les installations domestiques. Ils
protegent à la fois contre les surcharges et les court-circuits Classe
gG : ce
sont les fusibles utilisés dans les installations domestiques. Ils
protegent à la fois contre les surcharges et les court-circuits |
 Classe
aM : ce sont les fusibles
d'accompagnement moteur, que l'on utilise pour protéger contre les
court-circuits et les fortes surcharges les installations alimentant les
moteurs. Il convient de les associer avec des dispositif de protection contre
les faibles surcharges (relais thermique). Classe
aM : ce sont les fusibles
d'accompagnement moteur, que l'on utilise pour protéger contre les
court-circuits et les fortes surcharges les installations alimentant les
moteurs. Il convient de les associer avec des dispositif de protection contre
les faibles surcharges (relais thermique). |
 Classe
aD : ce sont des fusibles prévus pour
accompagner les disjoncteurs. Ils sont placés en amont du disjoncteur.
Ils ne doivent rentrer en action uniquement en cas de défaillance
du disjoncteur . Classe
aD : ce sont des fusibles prévus pour
accompagner les disjoncteurs. Ils sont placés en amont du disjoncteur.
Ils ne doivent rentrer en action uniquement en cas de défaillance
du disjoncteur . |
2.4.
Caractéristiques des fusibles
Les
fusibles sont caractérisés par :
- Un,
la tension nominale : (250V, 400V, 500V, 600V)
- In,
le courant nominal : c'est le calibre du fusible
ou de la cartouche fusible. (10A, 16A, 20A, 32A, 63A...)
- Inf,
le courant de non fusion : c'est la valeur du courant qui peut être
supporté par l'élèment fusible pendant un temps conventionnel,
sans fondre.
- If,
le courant de fusion : c'est la valeur du courant qui provoque la fusion de
l'élèment fusible avant la fin du temps conventionnel.
Calibre
en A |
Inf |
If |
t
: temps conventionnel |
|
inferieur
à 4 inclus |
1,5
In |
2,1
In |
1h |
de
4 à 10 inclus |
1,5
In |
1,9
In |
1h |
de
10 à 25 inclus |
1,4
In |
1,75
In |
1h |
de
25 à 63 inclus |
1,3
In |
1,6
In |
1h |
de
63 à 100 inclus |
1,3
In |
1,6
In |
2h |
de
100 à 160 inclus |
1,2In |
1,6
In |
2h |
de
160 à 400 inclus |
1,2
In |
1,6
In |
3h |
plus
de 400 |
1,2In |
1,6
In |
4h |
| exemple
: pour un fusible de 10A, le fusiblen'aura toujours pas fondu au bout d'une
heure pour un courant de 15A et aura fondu au bout d'une heure pour un courant
de 21A. |
- Durée
de coupure : c'est le temps
que met l'élèment fusible pour fondre et interrompre le courant.
- PdC,
le pouvoir de coupure : c'est le courant maximal que peut interrompre le fusible.
le pouvoir de coupure est de l'ordre de 6kA pour un fusible domestique.
Courbe
de fusion d'une cartouche cylindrique type gI
|
 |
cette courbe et
celle d'une cartouche fusible de calibre 20A.
(pointer
sur la courbe pour obtenir de plus amples informations) |
Voir aussi
le document du constructeur LEGRAND
3.
LES DISJONCTEURS MAGNETO-THERMIQUES
3.1.
Définition
Le
disjoncteur est un appareillage de protection pouvant établir,
maintenir (pendant un court instant) et interrompre le courant de court-circuit.
Le
disjoncteur rempli aussi la fonction de commande (manuelle ou télécommandée
suivant les cas) ainsi que la fonction de sectionnement.
Un
disjoncteur divisionnaire assure la protecion des conducteurs alimentant
les circuits terminaux contre les surcharges et les court-circuits. |
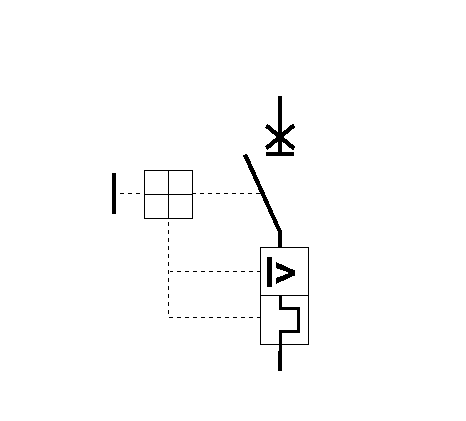 |
3.2.
Constitution
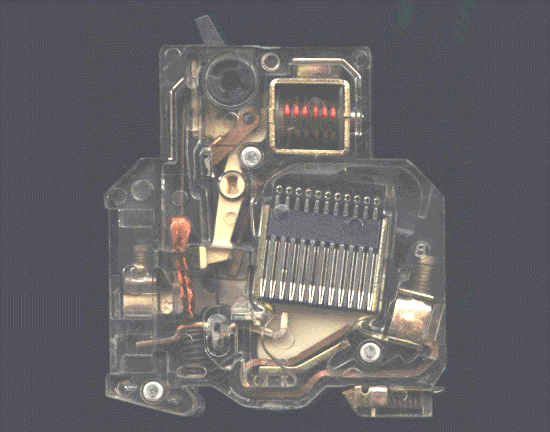
vue interne d'un disjoncteur divisionnaire.
3.3.
Fonctionnement
Protection
contre les surcharges :
lorqu'apparait
une surcharge, le dispositif thermique (bilame) détecte la perturbation
et agit sur le mécanisme de déclenchement, provocant l'ouverture
des contacts ou pôles du disjoncteur.
Le
bilame simule l'échauffement des conducteurs de l'installation
située en aval du disjoncteur, si cet échauffement est trop
important il convient d'interrompre l'alimentation avant que les conducteurs
ne se déteriorent, en revanche, si la surcharge est transitoire,
les conducteurs n'ont pas le temps de chauffer et il est inutile de couper
l'alimentation.
Sur
certains disjoncteurs, on peut régler dans une certaine plage,
la valeur du courant pour laquelle il y aura déclenchement thermique. |
 |
Le bilame est constitué
de deux lames métalliques solidaires l'une de l'autre.
A la température
ambiante, les deux lames ont la même longueur, en revanche, lorsque
la température augmente, une des deux lames se dilate plus que
l'autre. Comme les deux lames sont solidarisées, le bilame se déforme
en arc de cercle , permettant ainsi à la lame la plus dilatée
de s'allonger (longueur de l'exterieur de l'arc plus grande que la longueur
interieur de l'arc)
Le courant qui
traverse le disjoncteur circule dans des conducteurs qui ensèrent
un bilame. Par effet Joule, le courant de surcharge provoque l'échauffement
et la déformation du bilame, entrainant le déclenchement
du disjoncteur. |
Protection
contre les surintensités :
lorsqu'apparait
un court-circuit, le dispositif magnétique détecte le fort
courant et agit sur le mécanisme de déclenchement provocant
l'ouverture des contacts ou pôles du disjoncteur.
Il
convient d'interrompre le courant de court circuit le plus rapidement
possible, car les intensités mises en jeu alors peuvent provoquer
la fusion des conducteurs de l'installation et allumer des incendies.
c'est pour ces raisons de rapidité que le dispositif de détection
fonctionne sur la base du magnétisme
Sur
certains disjoncteurs, on peut régler dans une certaine plage,
la valeur du courant pour laquelle il y aura déclenchement magnétique. |
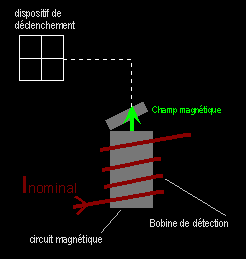 |
Lorsque
le courant est inférieur au courant de déclenchement magnétique
du disjoncteur (généralement entre 6 et 20 fois le courant
nominal), le champ magnétique créé par la bobine de
détection est trop faible pour actionner le mécanisme de déclenchement.
A l'apparition d'une surintensité, le champ magnétique devient
suffisamment important pour actionner le déclencheur. |
Interruption
du courant de court-circuit : elle est assurée par le pôle disjoncteur
L'intensité
du courant lorsque l'on est en présence d'un court circuit est,
pour un simple disjoncteur divisionnaire d'une installation domestique,
de l'ordre de quelques kiloAmpères.
Lorsque
l'on tente d'ouvrir le circuit sur une telle intensité, un arc
électrique prend naissance entre les deux lames du contact. |
Sous
l'effet du champ électrique, l'air s'ionise et le courant électrique
peut circuler : c'est l'arc électrique. Plus l'arc électrique
est long, plus la tension nécessaire pour ioniser l'air est importante.
Dans le cas du disjoncteur, la tension est fixée par le réseau
et donc l'arc possede une longueur limite qu'il ne peut pas dépasser.
Pour
eteindre l'arc, il suffit donc de l'allonger au dela de sa longueur limite. |
L'arc
électrique présente une résistance qui croit avec sa
longueur. Ceci est bénéfique, car cette résistance
va faire diminuer le courant de court circuit dans l'installation. Cependant,
l'arc électrique dégage beaucoup d'énergie thermique,
et il convient de l'éteindre le plus rapidement possible pour éviter
la détérioration du disjoncteur. |
| Pour
des raisons d'emcombrement on ne peut pas écarter suffisament les
deux contacts pour que l'arc s'éteigne de lui même, il convient
donc d'allonger l'arc et de le fragmenter dans une chambre de coupure : |
Pourquoi
l'arc électrique s'allonge-t-il ?
lorsque
l'arc prend naissance, il commence à chauffer l'air environnant,
ce qui provoque un courant de convection vers le haut. L'arc est alors
soufflé vers le haut et s'allonge puis se fragmente dans la chambre
de coupure pour finalement disparaitre : le courant est alors totalement
interrompu.
remarque
: la partie mobile du contact est "cornue", cette forme permet
de faire monter l'arc électrique tout en l'allongeant (et donc
en réduisant le courant de court circuit). Aussi, l'arc ne stagne
pas à l'endroit ou s'établi le passage du courant lorsque
le contact est fermé, évitant la dégradation de cette
surface, garantissant une conservation des bonnes qualités de contact. |
 |
3.4.
Caractéristiques des disjoncteurs
- Un,
la tension nominale : de 230V à 700V pour la BTA
- In,
le courant nominal : c'est le calibre ou la taille
du disjoncteur. (10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 63A...)
- le
nombre de pôles : de 1 à 4 suivant les applications.
- PdC,
le pouvoir de coupure : c'est le courant maximal que peut interrompre le disjoncteur.
le PdC doit être superieur au courant présumé de court
circuit.
- les
déclencheurs utilisés : Thermiques seuls, magnétiques
seuls, magnéto-thermiques, temporisés ou non, dispositif de
detection à courant résiduel (differentiel).
- Courbes
de déclenchement :
 |
courbe de déclenchement type U :
le déclenchement magnétique est réglé autour
de 6.In |
|
| |
|
 |
courbe de déclenchement type D :
le déclenchement magnétique est réglé éntre
15 et 20.In.
les disjoncteurs typeD sont utilisés lorsque l'on veut proteger
des installations susceptibles d'alimenter des équipement à
fort courant de démarrage. |
|
|



